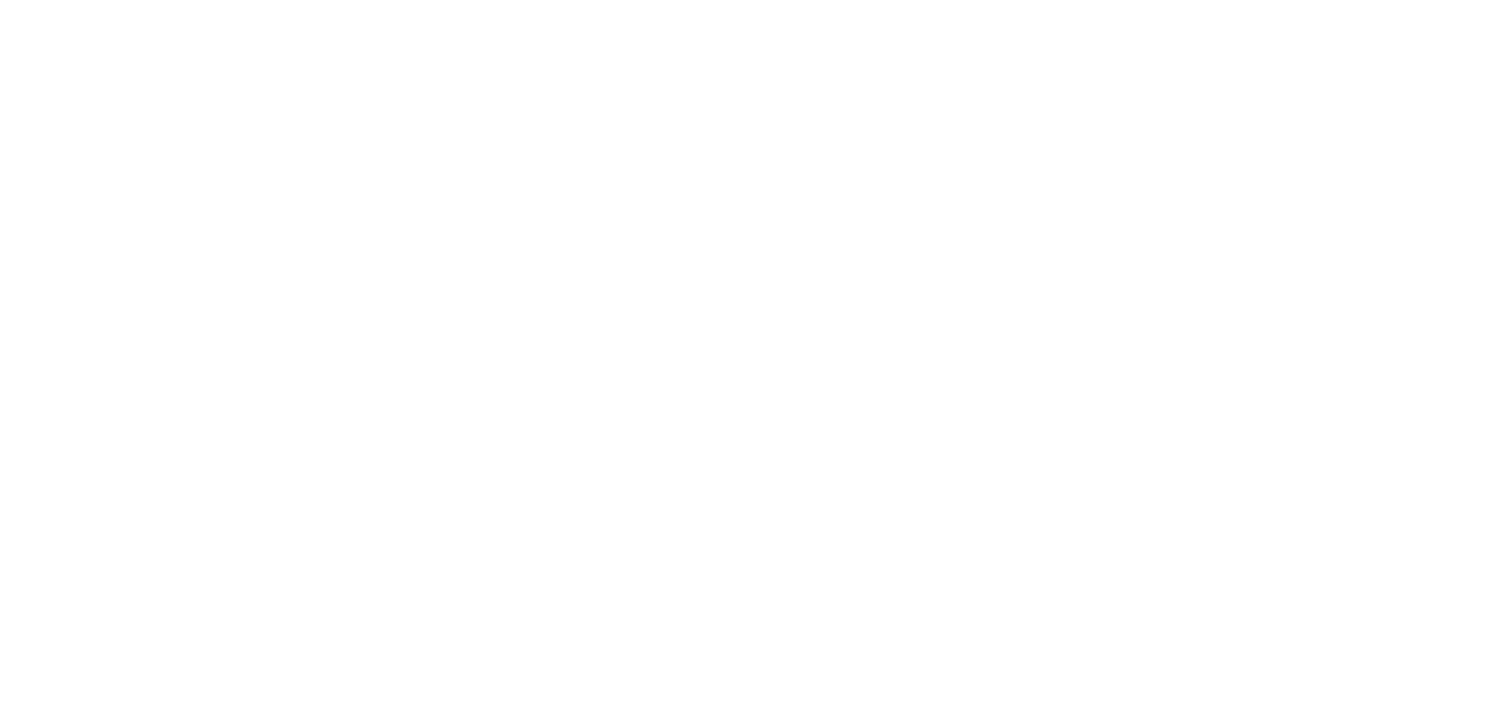PENSER CONFINÉ 1/5 — LE MYSTÈRE ANDROMÈDE
Par Nicolas Tellop
Dans Le Mystère Andromède de Robert Wise (1971), Une sonde spatiale américaine s’écrase dans la petite ville de Piedmont, au Nouveau-Mexique. Rien d’anormal, pas de réelle inquiétude, aucune urgence : l’événement appartient déjà à une espèce de routine, une simple procédure. Sauf que les deux hommes chargés de sa récupération, arrivés sur place, découvrent une bourgade fantomatique et ne tardent pas à débusquer des cadavres sur leur route. Eux-mêmes ont à peine le temps de paniquer qu’ils meurent, foudroyés. Piedmont est contaminée par un virus mortel.
Robert Wise met en exergue le voyeurisme morbide auquel se livre les deux scientifiques, et le spectateur avec eux. Que regarde-t-on au juste ? Un fragment de vie fixé pour l’éternité, ou la mort en ses œuvres ?
S’ensuit, un peu plus tard, une séquence fascinante et glaçante, caractéristique du cinéma catastrophe : non pas la vision de l’effondrement et de la destruction en tant que telle, mais des images de l’après, la visite des vestiges, le spectacle des empreintes laissées par une mort inconnue et sans visage. Largués depuis un hélicoptère, deux scientifiques en combinaison hermétique, blanche, errent dans les rues de la ville désertée par la vie et s’arrêtent devant chaque cadavre. On croirait voir deux cosmonautes explorant une planète inconnue, une terre qui n’est plus colonisée que par la mort, un lieu hors du temps, un moment hors du monde. Un homme qui promenait son chien, deux enfants qui jouaient au basket-ball, une femme qui venait de faire ses courses : toutes les dépouilles frappent d’autant plus qu’elles sont figées à un moment de leur vie de tous les jours. L’un des scientifiques écarte le diagnostic d’un accident coronarien en observant que les visages ne sont pas déformés par la douleur. En effet, nul masque grimaçant, mais des bouches ouvertes, exprimant pour l’éternité la surprise en une moue interloquée, sans joie ni mécontentement.
Douze ans plus tôt, le monde d’après que découvrait Ralph Burton dans les premières minutes hallucinantes du film Le Monde, la chair et le diable (Ranald McDougall) était marqué par une étrangeté tout onirique : un « poison atomique » a été lancé sur les États-Unis, les habitants ont fui les grandes villes et tout le monde – ou presque – est mort. Et pourtant, Ralph ne découvre sur son chemin pas un seul cadavre : uniquement des voitures abandonnées, des appartements désertés et des rues inoccupées. Rien que du vide, du vide et son écho qui résonne partout, qui ramène New York au rang de titanesque fossile dans lequel se serait figé l’envers de notre vie. L’errance des deux scientifiques dans Piedmont est d’une nature à la fois comparable et dissemblable. Y règne plutôt une atmosphère surréaliste, grotesque. Regardant à travers les fenêtres d’un pâté de maisons, les deux touristes de la mort pénètrent dans des intimités pétrifiées : un vieil homme dans son fauteuil, une femme effondrée devant son frigidaire ouvert, une autre étendue au milieu de ses bigoudis, une petite fille serrant une poupée dans ses bras, une séduisante jeune femme le torse nu. En achevant son panorama sur ce tableau, dont la vue est plus longue que les autres, Robert Wise met en exergue le voyeurisme morbide auquel se livrent les deux scientifiques, et le spectateur avec eux. Que regarde-t-on au juste ? Un fragment de vie fixé pour l’éternité, ou la mort en ses œuvres ? Le split screen très graphique que le montage adopte alors donne à voir à la fois l’intérieur des maisons, figé, et l’extérieur où évoluent les deux héros. Le contraste entre les deux fonctionne sur le régime de l’incompossibilité, comme si deux mondes étaient là superposés sans pour autant pouvoir se rencontrer – le split screen traduisant la nature hétérogène des deux réalités représentées. Piedmont est suspendu entre un moment de vie et l’instant de sa mort. Le monde d’après y est plus vraisemblable que celui sans cadavres du Monde, la chair et le diable, mais il n’en est pas moins inacceptable. Le film de MacDougall montrait la vie absente, celui de Wise expose la présence de la mort.
Une chose manque à l’horreur de notre expérience actuelle, si nous voulions la rapprocher de l’étrangeté presque surnaturelle de ce genre de films : nos morts.
Depuis le début de la pandémie du coronavirus, nombreuses ont été les références et analogies avec des films (post)apocalyptiques de contagion, dont Le Mystère Andromède. Et pourtant, une chose manque à l’horreur de notre expérience actuelle, si nous voulions la rapprocher de l’étrangeté presque surnaturelle de ce genre de films : nos morts. Même les proches et les familles endeuillées ne peuvent pas les voir – il ne leur est pas permis de leur adresser un dernier au revoir. Précautions sanitaires, certes. On peut l’accepter. On le doit. Mais pour ce qui est d’en parler… Le lundi 13 avril, lorsque le président Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement progressif prévu pour le mois suivant, il n’a pas eu une seule parole pour ceux qui étaient décédés du Covid-19. Il a salué le courage des soignants, les efforts de tous, mais n’a pas évoqué le nombre de victimes disparues jusque-là. Il s’élevait à 14 393. Depuis, on parle de moins en moins des morts. On n’a à la bouche que le déconfinement annoncé. Et pourtant, le 15 avril, le bilan n’a jamais été aussi catastrophique. Plus de 1 400 décès du Covid-19 en cette seule journée. Aucun média ne s’en est fait l’écho. Sur toutes les chaînes de télévision, on ne parlait que des chiffres de l’étranger. Du côté de la politique comme de celui des médias, le but est clair : il faut cacher les morts pour pouvoir rouvrir. Il faut stériliser la mort, à défaut de pouvoir sauver des vies.
La suite du Mystère Andromède pourrait illustrer notre réalité. Ou du moins, ce pourrait en être l’allégorie anticipée. Un groupe de scientifiques est confiné dans une base souterraine ultrasecrète, baptisée Wildfire, pour travailler sur ce virus inconnu. Du fonctionnement automatisé de Wildfire aux arcanes déshumanisés du pouvoir politique, tout est marqué par la figure de l’aliénation. Jean-Baptiste Thoret l’explique parfaitement dans « L’illusion technologique », le supplément à l’édition DVD du Mystère Andromède : Wise et Michael Crichton (qui a écrit le roman est à l’origine du film) décrivent autour de Wildfire un environnement transparent, sans relief, sans identité, sans signe distinctif, formaté, où toute trace d’humanité est indiscernable. C’est un monde où la science ne sert plus la cause de l’homme et où la montée technologique se montre inquiétante. En effet, dans un geste qui flirte avec l’abstraction, le film s’attarde longuement sur la technique, ses outils, leur fonctionnement, saturant l’image de courbes, de diagrammes, d’écrans, de claviers d’ordinateurs, de voyants divers, d’instruments automatisés, de portes sécurisées, de procédures codées – sans parler de la bande-son qui mêle à la musique électronique de Gil Mellé des voix préenregistrées, des signaux d’alerte et des bips-bips en tous genres. Tout cet attirail se révèle impuissant face au virus ; pire, il se retrouve à deux doigts d’en aggraver la menace et de précipiter sa létalité à une échelle mondiale. De même qu’il est question d’atomiser le village de Piedmont, Wildfire est pourvu d’un système d’autodestruction nucléaire, au cas où l’intégrité des lieux serait compromise. Or, il se trouve que le virus extraterrestre se nourrit de toute forme d’énergie et qu’il prolifère à son contact. Dans le film, plus que le virus, la technique et ses procédures inflexibles ont failli causer la fin du monde. En 2020, ce n’est pas tant la technique que la technocratie présidentielle qui assume cette épouvantable posture. En privilégiant à la santé publique le fonctionnement de l’État et les rouages de l’économie, Emmanuel Macron se confond avec Wildfire. Il ne semble pas mesurer les risques qu’il prend en soustrayant de ses calculs toute forme d’empathie et d’humanité. Emmanuel Macron n’atomise pas les morts, il les cache. Il ne veut pas détruire le virus, il veut le minimiser. Mais cette politique court le même risque que dans Le Mystère Andromède : celui de démultiplier les morts, celui de décupler l’impact du virus.
Dans le film, plus que le virus, la technique et ses procédures inflexibles ont failli causer la fin du monde. En 2020, ce n’est pas tant la technique que la technocratie présidentielle qui assume cette épouvantable posture.
Dans une interview accordée au Point le 15 avril 2020, Emmanuel Macron dit « assumer totalement » ses choix. « Si le Conseil scientifique m’avait dit que les maintenir [le premier tour des élections municipales, ndlr] mettrait la santé des Français en danger, je ne les aurais pas maintenues. J’assume totalement la décision. Si le Conseil scientifique nous éclaire par des avis, il y a tout au long de cette crise un ordre politique et un ordre scientifique. Les choix politiques sont faits par le pouvoir démocratique. » Rappelons que cette décision a entraîné beaucoup de malades avérés, ainsi que des personnes décédées. Emmanuel Macron assume-t-il aussi cela ? Non, il se contente de les ignorer. Il rappelle, tout en en inversant la figure, le président invisible du Mystère Andromède. Le nôtre est, hélas, omniprésent – pour le reste, il rappelle son épigone fictif qui, chez Wise, change sans cesse d’avis quant au lancement d’une bombe atomique en fonction des rapports contradictoires de scientifiques déboussolés.
La grande différence entre Le Mystère Andromède et notre situation, c’est que nos morts sont bien réels. Emmanuel Macron aussi, même s’il n’est que la caricature d’une démocratie dévoyée.