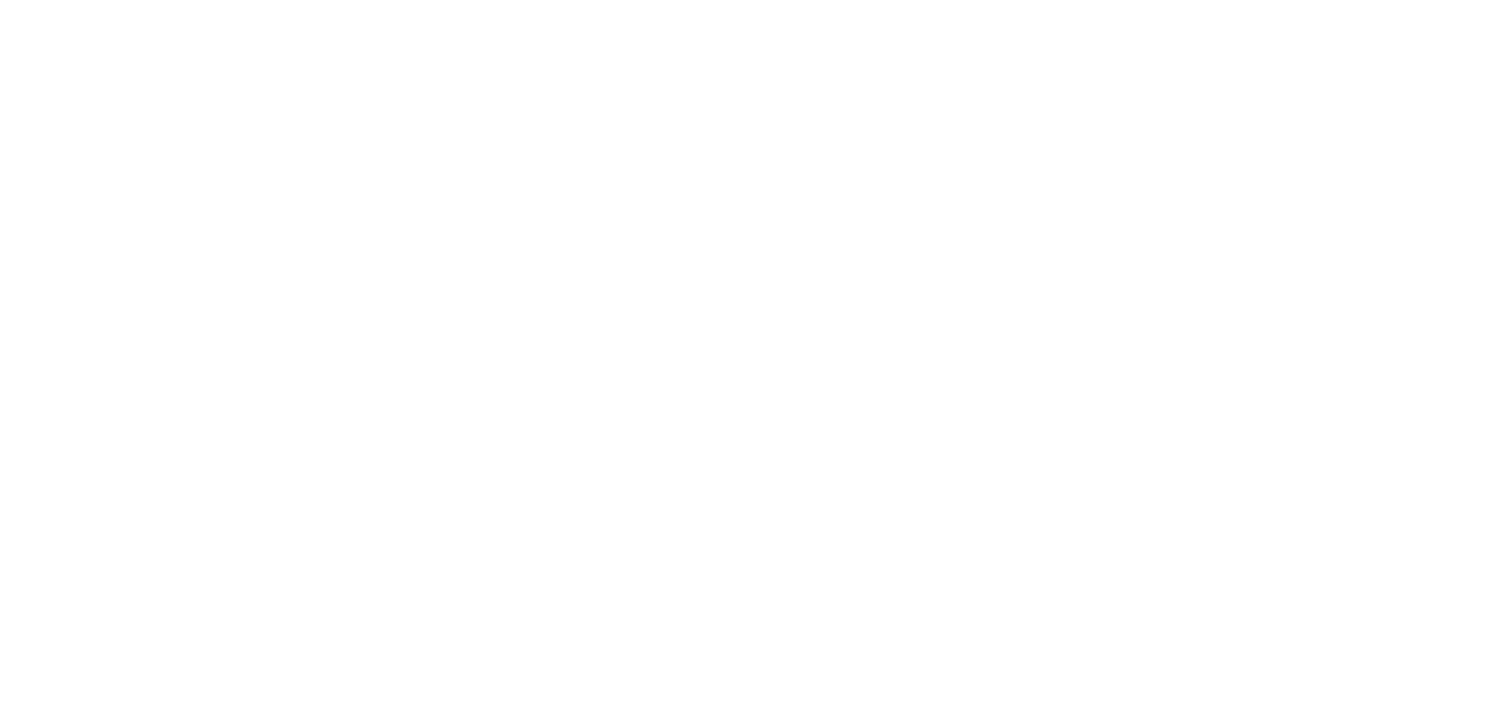PENSER CONFINÉ 3/5 — LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
Par Nicolas Tellop
L’une des scènes les plus marquantes de ce septième James Bond signé Guy Hamilton (1971) prend place dans la première partie du film. Bond (Sean Connery, en préretraite) a usurpé l’identité d’un escroc spécialisé dans la contrebande et autres passages en fraude : Peter Franks. À Amsterdam, il a pris contact avec une autre trafiquante, l’affriolante Tiffany Case (Jill St. John). Tout se déroule comme prévu, jusqu’à ce que le véritable Peter Franks, tout juste échappé de sa prison britannique, débarque au logement de la belle criminelle. Mais Bond, on ne la lui fait pas, et il l’attendait de pied ferme. Il entre avec Franks dans l’immeuble, joue au Hollandais jovial, fait semblant de sympathiser avec le patibulaire malfaiteur, prend l’ascenseur avec lui, lui demande son étage et, la cabine amorçant à peine son ascension, s’engage dans un corps-à-corps brutal.
C’est sans doute l’une des premières fois où un ascenseur sert de décor à une scène d’action qui maximalise l’exiguïté des lieux. D’autant que ce n’est pas un ascenseur de gratte-ciel américain, mais une cage à poules propre aux vieilles capitales européennes. Aucun recul envisageable, encore moins d’élan ou de repli, juste une promiscuité qui rend l’affrontement plus intense, parce que concentré, étouffant, oppressant. Le montage est sobre et lisible, loin du surdécoupage des scènes d’action des décennies à venir. Le champ de la caméra épouse l’habitacle de l’ascenseur, envisagé selon différents points de vue successifs. À la dynamique du montage, Guy Hamilton privilégie les ressources offertes par l’espace réduit de la cabine : on se heurte aux parois, on en brise les vitres, on appuie sans le vouloir sur les boutons de commande, faisant arrêter l’ascenseur, le faisant descendre, puis remonter, puis arrêter de nouveau. Rarement le cinéma aura autant incarné le corps du héros dans sa condition cinématographique, le faisant s’agiter et se cogner aux limites du cadre, ce cadre étant lui-même le véhicule de l’action, mû par un mouvement purement mécanique – une manière de métacinéma. Il y a un moment où Bond est à deux doigts de se faire arracher la tête par la cabine qui s’apprête à passer un étage, préfigurant d’une certaine façon le climax gore et ironique des Frissons de l’angoisse de Dario Argento, quelques années plus tard. Toutes les ressources du cadre limité sont donc mises au service d’une séquence qui fait rimer action avec tension, stress avec étroitesse.
Rarement le cinéma aura autant incarné le corps du héros dans sa condition cinématographique, le faisant s’agiter et se cogner aux limites du cadre.
La scène se termine sur le palier de Tiffany Case. Franks est raide mort et Bond profite de la confusion pour échanger leur portefeuille. Lorsque la belle receleuse de diamants cherche à connaître l’identité du cadavre, elle découvre qu’il ne s’agissait de nul autre que de Bond lui-même. Le vrai Bond joue la comédie avec regard ébahi et gros sabots : « C’était lui ?! » En quelques minutes, tous les enjeux du film ont été résumés. Sur le papier, Les diamants sont éternels ne parle que grands espaces (le désert, d’abord africain, puis américain, y occupe une place considérable) et même de conquête spatiale. Cela n’empêche pas le scénario de poursuivre obsessionnellement la double thématique de l’exiguïté et de la confusion des identités. À son arrivée aux États-Unis, Bond échoue dans un funérarium où il manque de subir, vivant, une crémation, enfermé dans un cercueil. Il ne s’en sort que parce que ses ennemis se sont rendu compte que les diamants qu’il venait de livrer étaient faux.
Plus tard, de nouveau assommé, Bond est abandonné dans un morceau de canalisation souterraine sur un chantier de construction. Encore inanimé, il est enterré et pris au piège d’un réseau labyrinthique (mais dont il se sort miraculeusement). Là encore, le motif de l’enfermement dans un espace restreint va de pair avec le trouble des identités. Dans la canalisation, Bond se réveille face à un rat et se demande lequel des deux sent si mauvais – après avoir senti ses propres habits, le héros adresse ses excuses au rongeur : c’est bien de lui-même que vient l’odeur. Dès le prégénérique du film, 007 est mis face à la question du double avec un faux Blofeld, le premier d’une longue liste. Et que dire de la belle Tiffany, qui change trois fois de couleurs de cheveux pendant les premières minutes de sa rencontre avec James (et qui, de vilaine fille, passe du côté des gentils) ?
Sean Connery considère l’espion de Sa Majesté comme un sombre idiot et craint de rester prisonnier de son personnage. D’où la claustrophobie permanente des Diamants sont éternels, reflet d’un acteur trop à l’étroit dans son rôle.
En menant de front ces deux thématiques, le film peut sembler interroger le personnage de Bond, surtout du point de vue de Sean Connery. Rappelons que l’acteur en a abandonné une première fois le rôle, qui ne lui a jamais convenu (On ne vit que deux fois devait être, en 1966, son dernier film pour la franchise). Il considère l’espion de Sa Majesté comme un sombre idiot et craint par-dessus tout de rester prisonnier de son personnage. D’où la claustrophobie permanente des Diamants sont éternels, reflet d’un acteur trop à l’étroit dans son rôle – d’où la vision d’un monde où les identités sont sans cesse interchangeables, miroir du malaise de Connery dans son interprétation de Bond. En mettant tout cela en perspective, le film est le premier de la série à verser dans un ton ouvertement plus léger, voire comique, faisant de chaque péripétie une sorte de jeu décomplexé, dont Las Vegas (principal décor de l’action) est le symbole. On comprend mieux pourquoi Sean Connery se disait très satisfait du scénario : ce n’était pas un James Bond de plus, c’était un exorcisme.
Isolés, comme reclus dans notre solitude, nous pourrions nous égarer dans des réflexions mensongères, illusoires, manipulatrices comme les médias de toutes sortes sont capables d’en produire.
Pour nous, aujourd’hui, à l’heure de la pandémie du Covid-19, le film nous met en garde. Les diamants sont éternels n’associe pas sans raison exiguïté et trouble identitaire : c’est que, confinés, concentrés à un seul endroit, nous risquons de perdre nos propres identités, de les mélanger, de les intervertir. Isolés, comme reclus dans notre solitude, nous pourrions nous égarer dans des réflexions abrutissantes, mensongères, illusoires, manipulatrices comme les médias de toutes sortes sont capables d’en produire. Discerner le vrai du faux, lorsque nous sommes coupés du monde réel, renfermés sur nos terreurs et alimentés en permanence par l’horreur et la confusion, est une grande gageure. Interdisons-nous de croire que l’autre sent plus mauvais que soi (comme nos autorités qui minimisaient la gravité du virus et qui considéraient d’abord l’Italie meurtrie avec condescendance, jugeant notre système de santé plus efficace que celui de nos voisins – suprême ironie !). Gardons-nous de nous laisser enfermer par le sépulcre politique, pour qui notre sort a toujours été réglé d’avance. Évitons de devoir nous pencher un jour sur le cadavre de notre raison et prononcer comme seule oraison : « C’était lui ?! »