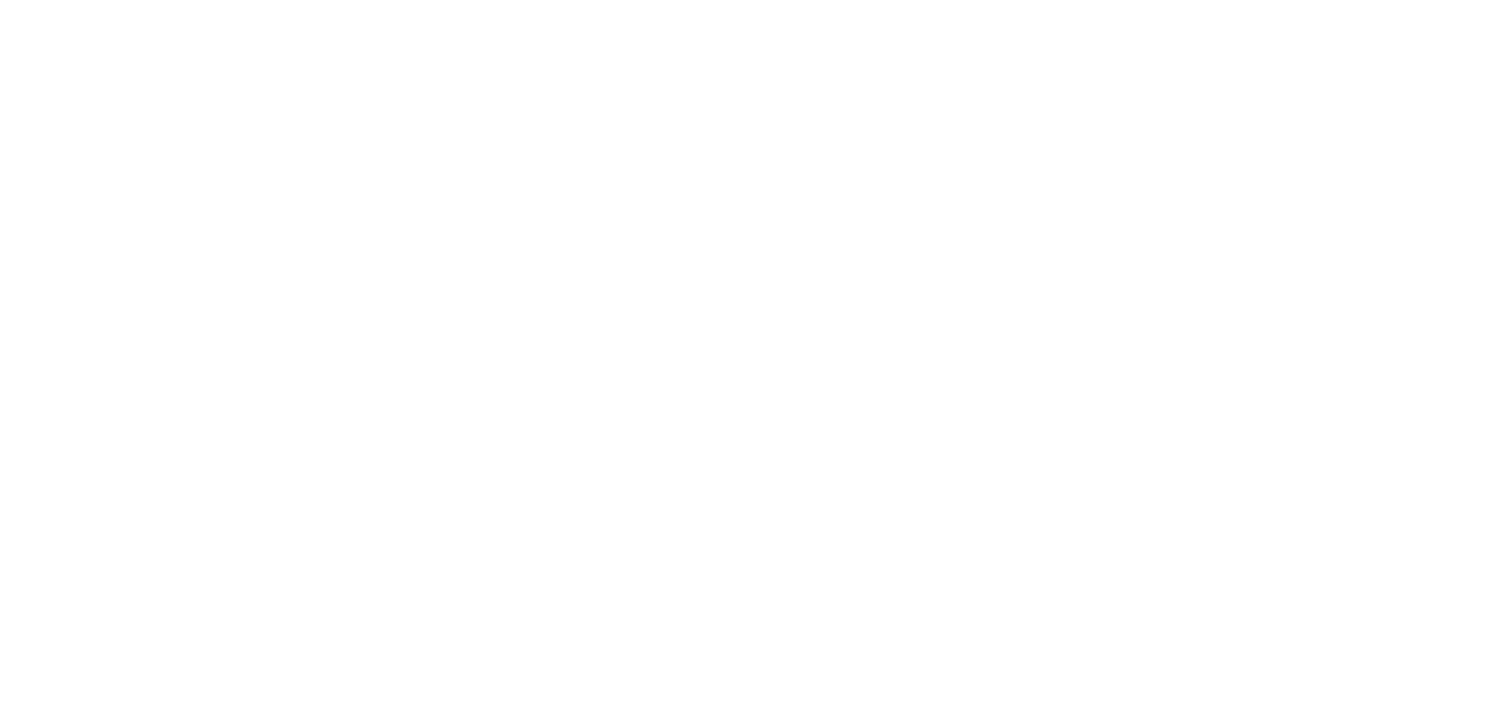[BABY] Entretien avec Marcelo Caetano
par Xavier Leherpeur
Baby de Marcelo Caetano, en salles actuellement (Epicentre Films)
Sao Paulo : intérieur queer
Avec le personnage de Wellington, votre film aborde plusieurs formes de marginalisation. La prison, le rejet par les parents, l'homosexualité… Qu'est-ce qui vous a donné envie de regarder ces formes de discrimination dans le Brésil d’aujourd'hui ?
Ce n'est pas une coïncidence. Au Brésil, quand tu es un homosexuel issu de la classe populaire, il y a accumulation d'exclusion et d'abandon. Et quand tu es dans ces situations-là, ta lutte et ta résistance sont plus fortes, plus dramatiques et donc plus émouvantes. Wellington est un personnage exclu trop tôt de sa vie et de la société. Il n'a pas eu l'opportunité de montrer sa puissance de révolte car il a été emprisonné. Lorsqu’il sort, c’est enfin pour lui l’occasion de trouver sa personnalité et de construire des liens familiaux alternatifs. Le moment de récupération et de recherche de lui-même.
Il y a une force de résistance inouïe chez vos héros…
Je disais tout le temps aux comédiens qu’il était très important de ne pas jouer les victimes. Lorsque nous discutions avant le tournage j’avais toujours recours à l’image de boxeurs sur un ring. C'est une aventure constante, tu ne dois jamais baisser la tête. Quand ils ont commencé à lire le scénario, des comédiens avaient tendance à dramatiser et victimiser leur personnage. Sans doute parce que Baby est très proche de ces drames humanistes et un peu sombres que l’on croise dans le cinéma mexicain ou chilien. Mais mes héros ne sont pas dans ce registre. Au Brésil, nous avons cette habilité de jouir même dans la merde la plus complète (rires).
Les amis de Wellington sont beaucoup plus fluides, beaucoup moins cisgenres que les gays quadras dansant en boîte sur Dalida. Aviez-vous envie de soulever la question discriminatoire du genre assigné, devenue en particulier avec Trump très politique…
On assiste en effet à une nouvelle violence contre la communauté LGBT et contre ces gens. Il s'est passé durant ces dernières années une révolution queer, acceptée, et qui estompe les limites entre masculin et féminin. Et cela a beaucoup changé la scène culturelle brésilienne. Nous sommes le pays qui a vu émerger les dragqueens et le voguing. En effet, je pense que c’est une menace pour les conservateurs comme Trump et Bolsonaro. Car cela représente vraiment une évolution culturelle très forte, comme celle des années 70. Je le constate d’ailleurs avec mes neveux et mes nièces qui ont une approche très différente des genres alors que nous vivons dans une culture très cadrée et basée sur les divisions de genre. Mais je pense que maintenant, c'est désormais la règle chez les jeunes. Même ceux qui ne sont pas LGBT. Je pense qu’il est important d'inviter les jeunes, les personnes des minorités, racisées et/ou queer, à occuper l'espace public et montrer notre visage au monde. Trump nous livre une guerre. Mais nous sommes très bien préparés pour lui faire face.
La ville de Sao Paulo est une héroïne de votre film…
C’est intéressant que vous pensiez la ville comme un personnage central. J’ai lu que Wong Kar-wai a comme méthode de travail le walking distance qui consiste à tourner en bas de chez lui. Dans les rues qu’il connaît. Je me suis inspiré de cette idée de limitation géographique. J’ai pensé aux endroits correspondant à des moments de ma vie. J’ai toujours vécu en centre-ville qui est historiquement un espace d'immigrants, d'homosexuels. Mais également très dur car abandonné par les institutions publiques. J’ai alors réfléchi aux questions de mémoire et d’espace. Je voulais filmer ces quartiers à l'échelle du corps des personnages pour regarder leurs mouvements dans la ville. Et pour ne pas stériliser cet espace-là, nous avons caché beaucoup de caméras dans les voitures ou sur les balcons, pour ne pas avoir à bloquer la rue et ajouter des figurants. Afin de garder intact le vivant.
Propos recueillis par Xavier Leherpeur à Paris (par zoom) le 7 février 2025